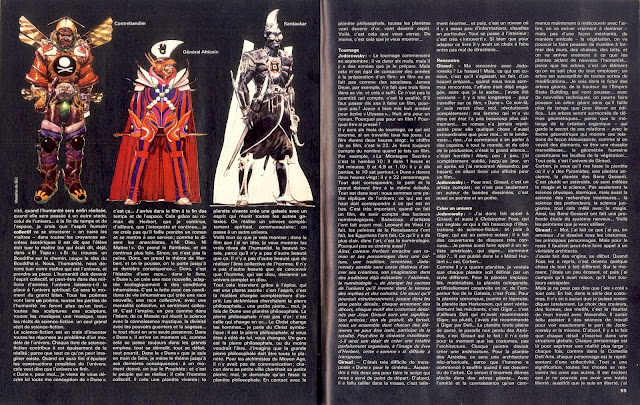Je suis mort.
Raisonnable, j'ai pensé à fermer mon blog avant.
Je peux pas poster ça.
Je l'enterre ici, à la date de sortie approximative de la VOD.
Tout ce qui nous permet d'échapper à la saison 8 de Game of Thrones est bon à prendre.
Sauf ça.
Les ombres bienveillantes de Jan Kounen, Gaspar Noé, Fabrice du Welz, Maurice Lynch, Nicolas Watzefok Refn, Apichatpong Weerasethakul, toutes les fées connues mais incornues d’un certain cinéma bis (plus un certain nombre dont j’ignore tout) se sont sans doute penchées sur le berceau de ce bébé de pellicule transgenres.
Pourtant ces grands noms du film malfaisant, ou à tout le moins malaisant, ne me viennent pas à l’esprit quand je regarde Mandy, qui ne ressemble finalement qu’à lui-même.
Je dis ça parce que je ne veux pas paraitre désagréable.
Je ne peux comparer ce film qu’avec ceux que je connais déjà.
Donc je m'abstiens.
Il présente assez de difformités à la naissance comme ça, ce pauvre petit bonhomme.
Inutile d'en rajouter par des commentaires désobligeants.
Chaque enfant qui vient au monde nous apprend que Dieu n'a pas désespéré de l'homme. (Tagore)
Sauf que Dieu n’a pas vu Mandy, enfin j’espère pour lui, et pour nous par voie de conséquence.
Ca pourrait le mettre dans de mauvaises dispositions.
Bref. Le film de Cosmatos dérange même les amateurs dérangés de films de genre, et interroge notre interrogation, nous qui sommes tristement normausés :
- Sommes-nous en présence d’un film « méta », qui dit quelque chose d’intelligible sur la pulsion scopique, celle-là même qui nous a fait répudier la culture classique et embrasser à pleine bouche la contre-culture un soir d’orage et d’élections défavorables à l’union des gauches plurielles où un grand dégoût des valeurs républicaines s'abattit sur nous ?
- Mandy relève-t-il d’un commentaire appuyé et vaguement moralisant sur les conséquences de l’abus des drogues chez les hippies dans les années 80 ?
Un personnage du film (évoquant Idris Elba sous chimiothérapie après avoir imprudemment accepté le tournage de la 6ème saison de Luther pour de basses raisons pécuniaires) révèle que la secte de bikers est devenue instable sur le plan psychologique après l’absorption d’un LSD volontairement trafiqué pour leur nuire, ce qui n’est pas très fair-play.
Mais si tel était son propos, ne verrait-on pas des cartons de prévention dans le générique de fin, enseignant avec pédagogie les méthodes pour acheter du LSD non frelaté ?
Or, j’ai regardé scolairement ma copie piratée jusqu’au bout, et au lieu de la traditionnelle hidden scène avec running gag après le déroulant te révélant que le film, soi-disant américain, est en fait tourné par un Grec en Belgique, ça recommence, mais sans son et sans les incrustations du générique de début qui t’informaient, au cas où tu t'en sois pas rendu compte, que tu étais en train d’écouter Starless par King Crimson, des fois que t’aies oublié de qui était cette mélopée gravée dans tes chairs du temps de tes tourments adolescents, et surtout au cas où tu aies écouté entretems
Deforming Lobes par
Ty Segall & Freedom Band juste avant d’aller au cinéma, auquel cas c’est normal que tu souffres de surdité partielle.
- Mandy s'érige-t-il tel un tombeau rutilant pour Nicolas Cage, magnifié-empaillé pendant 2 longues heures en Roi Saignant Couinant et Revanchard ?
on sent bien qu’au départ, il y a eu un scénario, qui servit à allumer le feu de camp dans l'enthousiasme un peu désordonné du premier tour de manivelle, puis l’équipe avala trois speedballs chacun en les faisant descendre d’une gorgée de mescal et s’attaqua directement au tournage des scènes coupées, avant de les assembler en ricanant nerveusement puis de mettre le bout à bout à disposition des aficionados de Nick (putain, Nick, merde, quand même, Arizona Junior c’était un film, quoi, t’es salaud, Nick…)
Alors, un western sous acide, brutal et cosmique ?? pas pour moi; j’en ai vu, des westerns sous acide, mais là, comment dire, il manque des bouts, et du temps a passé.
On est en 2018.
C’est un peu comme si vous alliez au restaurant parce qu’un copain avec une belle gueule vient d’en ouvrir un, mais une fois assis vous vous apercevez que le menu est écrit en runes, le serveur vous hurle dessus comme dans un épisode du Monty Python Tragic Circus, et les plats choisis au hasard arrivent à votre table tantôt froids tantôt brûlés, accommodés de sauces atroces.
Vous avez beau apprécier votre ami pour sa belle gueule et le féliciter pour sa cuisine (vous sautez le moment délicat de l’addition puisqu’on est sur un tracker privé où vous payez en nature, c’est à dire soit en temps passé à faire la vaisselle métaphorique en encodant vous-mêmes des films que vous soumettrez au groupe, soit à chercher ce que vous allez consommer après), et vous jurez dans votre ford intérieure que vous ne remettrez pas les pieds ici.
Même en termes de
revenge torture porn c’est indigent, les restaus coréens genre
J'ai rencontré le Diable (악마를 보았다 ) proposent 10 fois mieux.
L’aspect le plus vénéneux du film est son dispositif à vocation de tutoriel d'auto-hypnose (monologues récités lentement, en gros plan et face caméra dans une pénombre écarlate dénuée de servante mais ça serait pas pire) un peu comme le Lars Von Trier de Europa. Tiens, lui je l’avais oublié dans ma crise de name dropping.
Alors, un grand film
malade, un film
de malades ou un film
pour malades, dans l’attente que les labos sortent un vaccin ?
Je ne me prononce pas.
C’est un film qui m’étonne par son mélange de duplicité, de candeur et d'amnésie, mais dont je ne peux pas assimiler grand chose.
pour une vraie critique
c’est là, moi je m'occupe surtout de ce que le film n'est pas, pour décrire ce qu'il est il me faudrait plus de pages, et je vous rappelle que mon blog est fermé.